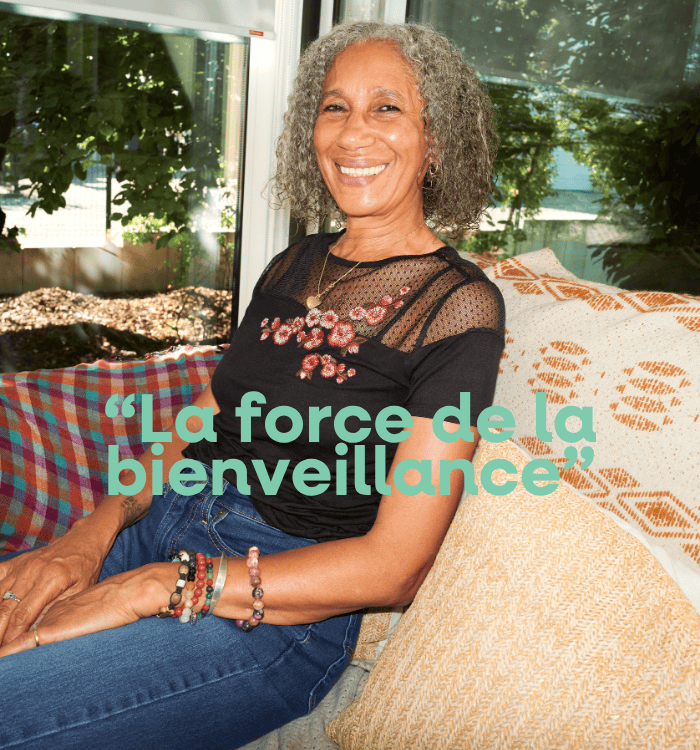Définition du prolapsus utérin : le terme prolapsus signifie « chute » en latin. Il se définit comme l’abaissement d’un ou plusieurs organes du petit bassin dans la paroi vaginale. Lorsque c’est l’utérus qui descend, on parle alors de prolapsus utérin. Cette descente d’organes provoque des sensations de gêne et d’inconfort pelvien chez la femme. Néanmoins, c’est un sujet dont on parle peu et qui reste souvent mal diagnostiqué.
Comment détecter un prolapsus utérin ?
Le prolapsus utérin, aussi appelé hystérocèle, est souvent lié à un plancher pelvien défaillant. Composé de tissus musculaires et de ligaments accrochés au pelvis, celui-ci est semblable à un hamac qui, une fois distendu, ne retient plus suffisamment les organes à leur place originelle.

Poser le diagnostic d’une descente d’utérus
On estime à une forte proportion le taux de prolapsus diagnostiqués trop tardivement, souvent par méconnaissance ou par honte. Il n’y a alors d’autre option que de recourir à une opération chirurgicale.
Il est important de faire un diagnostic précoce de cette pathologie. Plus le prolapsus est découvert tôt, plus son traitement est efficace. Les prolapsus les plus courants sont la cystocèle (descente de la vessie) et la rectocèle (descente du rectum). Les autres déclinaisons sont plus rares. Réagir rapidement est donc primordial.
Quels sont les différents types de prolapsus utérin ?
Trois curseurs existent pour établir le grade et la gravité d’un prolapsus :
- Débutant. C’est-à-dire qu’il se déclare encore en haut du vagin.
- Au niveau de l’orifice vulvaire sans le dépasser.
- Extériorisé en dépassant l’orifice vulvaire. Il s’agit d’un cas de figure particulièrement préoccupant puisque l’organe touché se trouve en partie expulsé hors du corps
Quels sont les traitements efficaces pour soigner un prolapsus utérin ?
Les traitements pour guéri d’un prolapsus utérin dépendent de la sévérité des symptômes et de la condition physique de la patiente. Les options les plus courantes sont :
- La rééducation périnéale : des exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien peuvent aider à mieux maintenir les organes génitaux et à réduire les symptômes ;
- Les pessaires : ce sont des dispositifs insérés dans le vagin pour soutenir l’utérus et réduire les symptômes du prolapsus utérin ;
- Les thérapies hormonales : parfois, des traitements hormonaux peuvent être prescrits pour renforcer les tissus pelviens ;
- La chirurgie : dans les cas les plus graves, une opération pour traiter la descente d’organe peut être recommandée pour réparer ou soutenir les tissus affaiblis.
Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et discuter des options de traitement adaptées à chaque cas individuel.
Qui peut souffrir d’un prolapsus utérin ?
Les statistiques montrent qu’en moyenne, une à deux femmes sur dix est susceptible d’être opérée d’un prolapsus au cours de sa vie et que le risque augmente avec l’âge.
Il s’agit d’une pathologie typiquement féminine puisque les hommes en sont toujours exempts, sauf dans les rares cas de chirurgie du rectum.
Prolapsus au post-partum
Parmi les principales causes de prolapsus génital, on peut citer les complications de l’accouchement (bébé lourd, épisiotomie, déchirures, délivrance par forceps), mais aussi celles du post-partum : charges lourdes portées trop précocement après l’accouchement ou reprise d’une activité physique avant le délai de 6 semaines. Mais cela n’est pas que l’apanage d’une maman qui vient d’avoir un bébé.
Ménopause et hystérocèle
On l’évoque moins, mais cette pathologie concerne aussi les sportives et les femmes à l’âge de la ménopause. Les variations hormonales et la carence en œstrogènes induites par la ménopause est un autre facteur favorisant des prolapsus.
Enfin, aux autres âges de la vie, les troubles alimentaires générant des carences nutritionnelles ou, a contrario, l’obésité, s’ajoutent à la liste des causes potentielles.
Sport et prolapsus
Les femmes qui pratiquent des sports engageants comme les marathoniennes voient les risques de prolapsus croître. Les fortes poussées au niveau de la ceinture abdominale ont un impact direct sur le plancher pelvien qui se voit alors fragilisé.
Prolapsus utérin et hérédité
Plus rarement, le prolapsus peut être transgénérationnel. Du moins, une de ses causes l’est : l’anomalie du tissu musculaire provoquée par certaines maladies héréditaires. Il s’agit toutefois de cas rares.
À cela s’ajoute une notion primordiale, qui est que le prolapsus, utérin ou non, est un mot tabou, cet « interdit » dont on ne peut pas parler et qui reste ancré même dans nos sociétés modernes.
En dépit de la libération progressive de la parole des patientes et du corps médical, la méconnaissance demeure grande auprès des femmes. Si on salue la création, en 2020, d’une page informative dédiée sur le site de l’Assurance Maladie – Ameli.fr –, le chemin est encore long pour que le grand public soit réellement au fait de ce qu’est le prolapsus.
En définitive, ne pas faire l’autruche et accepter de se laisser accompagner est la meilleure façon de faire face à un prolapsus !
Plus d'informations : POP France